MigrEurop : Déclaration de Calais : 18 décembre 215
Refusons l’encampement des exilées et la clôture des frontières
À l’occasion de ses dix ans, le réseau Migreurop était réuni le week-end dernier à Calais pour apporter son soutien aux exilés retenus dans les nasses du Calaisis, ainsi qu’aux militants et organisations engagées dans les luttes contre les politiques de chasse aux migrants pratiquées par les États français, britannique et par l’Union européenne (UE).
Ces trois jours de débats avec des militants venus de toute l’Europe, de Turquie et d’Afrique ont débouché sur un constat partagé. La fortification du port de Calais et du site d’Eurotunnel, appuyée par un harcèlement policier incessant, contraignent les personnes à tenter de passer en Grande-Bretagne dans des conditions de « clandestinité » toujours plus périlleuses. Il s’agit là de l’une des multiples déclinaisons d’une politique menée à toutes les frontières de l’Europe pour entraver la circulation des exilé·e·s. Elle va souvent de pair avec des conditions de vie misérables et une ghettoïsation qui les criminalisent (par des interdictions et des contrôles abusifs) et les coupent des populations et solidarités de proximité. Ces camps et autres bidonvilles sont le fruit de politiques européennes constamment réaffirmées, bien que mises en échec par les stratégies de contournement des migrants : l’utopie de frontières ouvertes aux seuls privilégiés de la mondialisation conduit à l’institutionnalisation de la maltraitance des exilés et non à mettre fin à l’exil…
Les dispositifs de surveillance et de contrôle (barrières de Ceuta et Melilla ou à l’entrée de la Macédoine, murs aux frontières gréco-turque et serbo-hongroise, patrouilles de l’agence Frontex et opération Sophia en Méditerranée…) sont censés maintenir les migrants loin de l’Europe. Ils interviennent en complément des politiques de non-délivrance de visas et de coopération avec les pays dits d’origine – y compris les plus dictatoriaux – appelés à entraver les départs. Les droits fondamentaux de millions de personnes, notamment celui de demander l’asile, sont ainsi bafoués. Faute de voies légales d’accès aux territoires européens, elles sont condamnées à des persécutions policières, à l’exploitation de leur misère par des passeurs, et à la survie dans des conditions d’extrême précarité. Ces dernières ne peuvent qu’aggraver les traumatismes liés aux guerres et aux violences multiples auxquelles ces exilés tentent d’échapper.
Dans le Calaisis, la double barrière juridique du traité du Touquet (qui fixe les conditions de la sous-traitance à la France du contrôle de la frontière britannique) et des accords de Dublin III (qui obligent les demandeurs d’asile à déposer leur demande dans le premier pays de l’UE traversé) rend impossible que Soudanais, Syriens, Irakiens, Erythréens, Afghans… demandent l’asile au Royaume-Uni. En 2014, le Royaume-Uni n’a ainsi reçu que 30 000 des 630 000 demandes d’asile enregistrées dans l’Union européenne. Ce nombre, en baisse depuis plusieurs années, ne devrait pas connaître d’évolution majeure en 2015, alors même que les arrivées dans l’UE ont connu une augmentation qualifiée d’« historique ».
La situation que connaît le Calaisis depuis près de 20 ans (le camp de Sangatte « fermé » en 2002 avait ouvert en 1999) est symptomatique des politiques que prône avec une constance aveugle l’Union européenne. Ainsi, les projets de « hotspots » et de « processing centres » se traduiront immanquablement, s’ils sont effectivement mis en oeuvre, par la création d’immenses centres d’enfermement en Italie, en Grèce mais aussi au Niger et en Turquie. « L’encampement », le plus loin possible des regards des sociétés civiles, est bien l’horizon ultime des politiques migratoires de l’Union européenne : à force de trier les migrant·e·s, elle en arrive à violer les droits humains les plus fondamentaux, voire à provoquer la mort de nombreux exilé.e.s.
Le réseau Migreurop tient solennellement à réaffirmer que le respect des droits et de la dignité humaine exige que cesse toute forme d’enfermement et de ghettoïsation des personnes exerçant leur droit à quitter leurs pays. Les conditions d’un accueil digne, dans le Calaisis et ailleurs, passent aussi par l’abolition du règlement de Dublin et de son cortège de renvois forcés. Il doit aussi être mis fin aux multiples contrôles liés aux accords franco-britanniques (tels celui du Touquet) qui ont transformé la frontière en clôture au lieu d’en faire un lieu de passages légaux et protégés.
Il faut le savoir
Les demandeurs d'asile, hors du "plan" gouvernemental ne peuvent pas bénéficier du RSA (540€/mois).
Par contre, ils peuvent prétendre à l'ATA (Alloc Temporaire d'attente - jusqu'à l'obtention de la réponse de l'OFPRA).
Or au 1er novembre 2015, l'ATA deviendra l'ADA (Alloc pour Demandeurs d'Asile).
Les éléments d'attributions et montant sont restés inconnus jusqu'à il y a quelques jours (même les travailleurs sociaux étaient dans le flou).
Les chiffres viennent de tomber.
L'ATA (jusqu'au 1er nov) était de 11,35€ par jour, soit 343€/mois.
L'ADA (à part du 1er nov) sera de 6,80€ par jour, soit moins de 200€/mois !!!! Sans aucune aide de 'substitution'.
A leur arrivée, Yamen et Tarek ont accusé le coup en apprenant qu'ils ne bénéficieraient pas du RSA, mais de l'ATA. À présent, il me faut leur annoncer que ce sera encore moitié moins.
Actuellement ils ne bénéficient de rien du tout, car les choses, bien que lancées administrativement, ne sont pas encore en place. Ce devrait être pour décembre (ils sont arrivés mi septembre...).
Si les choses se clarifient administrativement ( directives), ce n'est pas un mal. Surtout que l'Association du foyer Notre Dame est plutôt compétente et sous-traite un certain nombre de services. Par exemple au CASAS.
La baisse de l'allocation ADA et surtout les nouvelles récurrentes de l'incohérence coupable de notre gouvernement en matière de "gestion" des personnes en situation de migration, ne doivent pas nous décourager.
Lundi soir, nous aurons Conseil d'inspection. Peut-être que nous pourrons imaginer des actions de solidarité concrète, avec les jeunes de l'inspection? Les personnes du troisième âge lors des fêtes de Noël ? Jésus est né enfant de demandeurs d'asile, ce n'est pas rien comme argument.
Hier soir a eu lieu la conférence d'Anne-Marie Heitz-Muller sur les femmes des réformateurs strasbourgeois. Elle a décrit le contexte d'émergence de de la Réformation. Et notamment évoqué le fait qu'à l’époque, Strasbourg était une ville qui de par son statut de ville libre pouvait accueillir des réfugiés. Vocation qu'elle a grandement réalisé. Ainsi, en l'an 1530-31, l'hivers fut très vigoureux, de nombreuses personnes se sont retrouvées sur les routes pour trouver survie ailleurs. La ville a accueilli 2 500 réfugiés, soit 10% du chiffre de sa population totale! Et les réformateurs, leurs formidables épouses en particulier, on pris à cœur cet accueil, l'une d'elle nourrissant des dizaines de personnes quotidiennement.
Ensemble, nous trouverons bien des solutions!
Aujourd'hui, nous fêtons en grande pompe la Réformation et il est bon de se souvenir que c'est la crédibilité et cohérence évangélique des réformateurs comme de toutes ces femmes et hommes mobilisés par un élan de foi qui a donné un formidable essor à la nouvelle spiritualité protestante.
Merci beaucoup à chacune/chacun qui veille/agit déjà sur le front de l'accueil, que nos prières vous soutiennent!
Anne-Christine HILBOLD-CROISET
pasteur à Berstett
31 octobre 2015
Du refuge huguenot aux réfugiés actuels, un même fil rouge ?
Réforme 15.10.2015
L’historien rappelle que le terme de « réfugié » prend sa source dans les premiers temps de la Réforme et devrait inspirer davantage nos contemporains.
À lire
La Révolution anglaise
Bernard Cottret
Perrin
606 p., 26 €.
Le sort des réfugiés suscite commentaires, interrogations, polémiques même. Il est nécessaire de appeler l’étymologie du mot « Refuge ». Les débats ne datent pas d’aujourd’hui. On ignore souvent que le mot « réfugié » s’applique, à l’origine, aux protestants français ayant quitté le royaume pour vivre pleinement leur foi à l’extérieur des frontières.
C’est au XVIe siècle, au temps des Réformes – et non, comme on le pense parfois au moment des dragonnades et de la révocation de l’édit de Nantes –, que se fixe le terme.
On commence à parler de Refuge en faisant référence à plusieurs passages de la Bible (on songe au psaume 91) dans lesquels est invoquée la protection que Dieu accorde à son peuple. Pour ceux qui s’affirmaient chrétiens authentiques, il s’agissait de vivre leur foi sans craindre d’être persécutés.
Calvin voulait éviter au maximum la violence religieuse ; la solution la plus raisonnable était de partir. Le « petit troupeau » des fidèles pouvait être tenté de se dissimuler, pour adorer l’Éternel dans le secret. Mais Calvin exhorte à la résistance ; il n’est pas question de donner le change en se conformant en apparence à l’ordre établi par l’Église romaine.
Le Réformateur fustige cette pratique en dénonçant les « pseudo-nicodémites », une expression construite à partir de la figure de Nicodème, qui va voir le Christ en secret. Ce compromis était perçu comme une menace, voire une trahison : aller à la messe en prétendant refuser l’idolâtrie semblait voué à l’échec. Ne serait-on pas contraint de participer à l’idolâtrie ? Mieux vaut quitter le pays afin de pouvoir effectuer son coming out spirituel. Le Refuge désigne cet espace indécis, en marge du royaume de France, qui va de Genève à Londres, en passant par Neuchâtel, Strasbourg, Francfort et Amsterdam, avant de s’étendre à l’Irlande et à l’Amérique.
Le pain des Anglais
Les réfugiés pour la foi étaient également des migrants économiques. Les Français arrivant en Angleterre après 1550 ont tout de suite demandé à travailler. Ils ont été, dans un premier temps, très bien reçus, parce qu’ils composaient une main-d’œuvre relativement bon marché et très bien formée, une élite de l’artisanat, des gens qui connaissaient bien leur métier, en un temps où les transferts technologiques passaient par l’apprentissage et le bouche à oreille.
La xénophobie n’a jamais disparu. Les Français viennent manger « le pain des Anglais », dit-on parfois. Qu’ils fussent protestants ne changeait pas grand-chose. Les Églises, organismes de gestion sociale et pas seulement spirituelle, tentaient de venir en aide aux réfugiés. Mais elles ont progressivement intégré les préjugés dominants face aux nouveaux venus. Au dix-huitième siècle à Londres, les Églises huguenotes ont rejeté les pauvres camisards au prétexte qu’ils leur semblaient trop fougueux, enthousiastes, incontrôlables. Certains appelaient à distinguer les « vrais réfugiés » des clandestins menaçants, parmi lesquels, disaient-ils, se cachaient peut-être des jésuites. Charité bien ordonnée…
Du côté des pays allemands, la réaction est très favorable. Le territoire que l’on appelle le Saint Empire romain germanique couvre une superficie considérable où la Réforme tient une place importante.
On y fait appel aux protestants de manière plus systématique après la révocation de l’édit de Nantes. Par l’édit de Potsdam du 29 octobre 1685, l’électeur de Brandebourg, Frédéric Guillaume, les a clairement appelés : « Comme les persécutions et les rigoureuses procédures qu’on exerce depuis quelque temps en France contre ceux de la religion réformée ont obligé plusieurs familles de sortir de ce royaume, et de chercher à s’établir dans les pays étrangers, nous avons bien voulu, touché de la juste compassion que nous devons avoir pour ceux qui souffrent malheureusement pour l’Évangile et pour la pureté de la foi que nous confessons avec eux, par le présent édit signé de notre main, offrir aux dits Français une retraite sûre et libre dans toutes les terres et provinces de notre domination, et leur déclarer en même temps de quels droits, franchises et avantages nous prétendons les y faire jouir, pour les soulager et pour subvenir en quelque sorte aux calamités avec lesquelles la providence divine a trouvé bon de frapper une partie si considérable de son Église. »
Il faut préciser qu’il était prince calviniste d’un peuple à majorité luthérienne. Il espérait, par l’apport des réfugiés français, peser sur l’évolution des communautés religieuses. Moyennant quoi, les sujets d’origine française comptaient au début du XVIIIe siècle pour un tiers environ de la population de Berlin.
Bien sûr, il faut se garder de toute caricature, éviter de comparer de manière systématique le début de notre siècle avec le temps de la Réforme. Si Angela Merkel fait politiquement étalage de son accueil des réfugiés, c’est aussi pour exorciser un passé récent. Polonais, Tchèques, Hongrois et Slovaques échaudés apprécient mal les donneurs de leçons.
L’Europe serait-elle appelée à succéder au Saint Empire ? La charité, l’ostentation vertueuse, l’autopublicité profitent autant à ceux qui les professent qu’à leurs bénéficiaires. Il est cependant évident que le traitement des réfugiés prend sa source dans des fondements théologiques et politiques qui méritent d’être mis à jour.
Propos recueillis par F. Casadesus

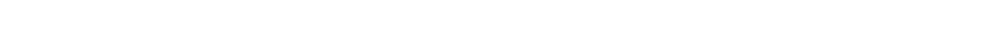
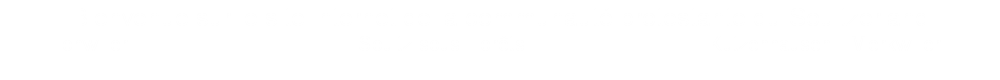

Paroisses protestantes du Soultzerland
Pasteur Schildknecht Romain - 15 rue des Barons de Fleckenstein - 67250 Soultz-sous-Forêts
Tél. 03.88.80.41.13 / 06.75.68.35.79 - Mail. protestants.soultzerland.romain@gmail.com
